La plus secrète mémoire des hommes.
Fado sur l'acte d'écrire.
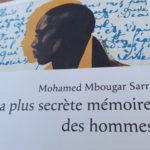
Résumé : un jeune écrivain sénégalais, Diégane Latyr Faye, tombe en 2008 sur un livre : Le labyrinthe de l’inhumain (dont on connaîtra peu de choses) écrit en 1938 par un autre jeune auteur africain nommé T.C. Elimane, auteur blessé qui disparut totalement de la circulation après que son chef-d’œuvre a fait l’objet, après les éloges, de virulentes critiques. Comme d’autres avant lui – Charles Ellenstein et Thérèse Jacob, les éditeurs dudit Labyrinthe, l’écrivaine sénégalaise Marème Siga D. dite « corazón » par la poétesse haïtienne (amante un temps dudit T.C. Elimane) et la journaliste Brigitte Bollème – ou après lui (l’écrivain zaïrois Musimbwa), Diégane, narrateur-héros (dont on ne connaîtra le nom qu’à la page 28) est foudroyé par sa lecture du livre et part à la recherche de ce mystérieux T.C. Elimane ou plutôt se met en quête de l’aboutissement de son « magnum opus », une éventuelle suite de son premier chef-d’œuvre –, Diégane protagoniste devant lui-même réaliser le sien… Vous avez saisi ? Parfait ! On continue.
« D’une perpétuelle inventivité, La plus secrète mémoire des hommes est un roman étourdissant »
4e de couverture
Elle ne ment pas… Si indéniablement Mohamed Mbougar Sarr est un excellent conteur (de la même veine que l’espagnol Pablo Martín Sánchez ou parmi de plus anciens, Jacques Abeille), ce roman pèche sur plusieurs points, facteurs d’une appréciation perturbée progressant en zigzag. Et sans prendre le contre-pied des avis dithyrambiques émis par un nombre important d’ « influenceurs » officiels (L’Express, Le Monde, Télérama…) ni sans être aussi dure que certains lecteurs, je considère que Mohamed Mbougar Sarr, écrivain véritablement prodige qui a suscité mon intérêt après son passage dans le 28’ d’Elisabeth Quin, n’a pas atteint pleinement son ambition conceptuelle dans cet ouvrage.
J’élague en premier le négatif…
Étourdissant par son contenu (l’histoire du livre dans le livre est captivante) mais aussi en la forme.
L’ouvrage est complexe, archisubdivisé – livres, parties et sous-parties (les « biographèmes ») s’enchaînent – tandis que s’emboîtent simultanément, de manière protéiforme (journaux, chroniques, lettres, rapport d’enquête façon thriller) dénotant cependant quelque peu après un tout-début du roman de haute volée bien orchestré par une présentation typographique élaborée, en reprenant partiellement de mêmes faits, créant des redondances qui seraient simplement qualifiées de « répétitions » dans un roman de composition moins élaborée.
Autre « légèreté » vis-à-vis du lecteur, ces mêmes faits et leurs compléments sont émis par la voix de multiples « Je » sans aucune marque distinctive typographique. On ne peut que supputer un « Je » qui se voulait sans doute unique mais dont le lecteur est contraint de le chercher fréquemment, un plus ou moins long temps perdant momentanément le fil.
"Lire (percevoir le lisible du texte), c'est trouver des sens, et trouver des sens, c'est le nommer"
Barthes
De même, si je serais bien la dernière à reprocher l’utilisation d’un vocabulaire recherché, celle qui y est faite, disséminée ici et là dans le texte sans condescendance envers le lecteur à l’aide d’un éclairage supplémentaire ou conjoint, a toutes les chances de rebuter celui dépourvu des connaissances appropriées.
Plus important, point de déception touchant le fond du livre, qualifié de « livre-monde », de roman « pluridimensionnel », si le livre est fabuleux sur tout ce qui a trait à l’acte d’écrire, enchanteur sur le plan de la fiction et que les « ingrédients » contemporains tels le rapport au sexe ou la consommation de shit m’ont semblé après-coup bien « gérés », les éléments objectifs choisis concernant l’Afrique « l’épine de la civilisation blanche » – à l’exception de la scène prenante du « puits » (guerres interafricaines) – ou le statut de l’Africain à Paris ou encore l’évocation de la Shoah entr’aperçue et celle de l’Argentine (pour une moindre part) m’ont fait maigre impression par rapport à la réalité et plutôt figure de clichés ou de pièces rapportées me laissant sur ma faim à l’heure de la globalisation, de la part notamment d’un auteur qui marche dans les pas d’un Gombrowicz, « écrivain de l’universel». Mohamed Mbougar Sarr m’avait paru beaucoup plus convaincant dans son interview télévisée.
Pour conclure sur cette partie formelle, une question a affleuré le seuil de mes méninges :
La plus secrète mémoire des hommes est-elle une autofiction ou plus exactement une « fictionnalisation de soi » ?
Oui et non.
Non : si l’on s’en tient aux critères restrictifs définitoires de l’autofiction. Le livre est dédicacé à Yambo Ouologuem, auteur malien, premier romancier africain auréolé en 1968 d’un prix littéraire d’envergure (le Renaudot) pour Le Devoir de violence qui aurait subi, selon Bulles de culture, l’élément déclencheur du livre :
« Après des critiques acerbes l’accusant d’impostures, il (Y. Ouologuem) disparaît de la scène littéraire dans les années 1970, se réfugiant sur sa terre natale, dans un total anonymat. »
Bulles de culture
Oui : en ce que Mohamed Mbougar Sarr se fictionnalise en Diégane (le narrateur-héros), en Siga D., en Musimbwa, en Magda… Toutes leurs réflexions sont siennes comme leur quête « la (terrible) alternative (existentielle) devant laquelle hésite le cœur de toute personne hantée par la littérature : écrire, ne pas écrire. »
Ce qui m’amène à ce qui constitue, à mes yeux, l’incontestable apport de ce livre : ce "fado" sur l’acte d’écrire, qui m’a émerveillée.
Je ne peux faire mieux que citer :
« La littérature m’apparut sous les traits d’une femme à la beauté terrifiante. Je lui dis dans un bégaiement que je la cherchais. Elle rit avec cruauté et dit qu’elle n’appartenait à personne. »
« Tu voudrais n’écrire qu’un livre. Tu sais qu’au fond de toi qu’il n’y en a qu’un seul qui compte : celui qui engendre tous les autres ou que ceux-ci annoncent. Tu voudrais écrire le biblicide, l’œuvre qui tuerait toutes les autres, effaçant celles qui l’ont précédée et dissuadant celles qui seraient tentées de naître à sa suite, de céder à cette folie. En un geste, abolir et unifier la bibliothèque. Mais tout livre visant à l’absolu s’élit à l’échec ; et c’est dans la vision lucide de cet échec prochain que bat le cœur ardent de l’entreprise. Désir d’absolu, certitude du néant : voilà l’équation de la création. La funeste prétention du livre essentiel est de cercler l’infini ; son désir, d’avoir le dernier mot face au long discours dont il est la plus récente phrase. Mais il n’y a pas de dernier mot. Ou, s’il y en a un, il ne lui appartient pas, puisqu’il n’appartient pas aux hommes. »
« Chaque homme sur terre doit découvrir sa question (…). Je ne vois pas d’autre but à notre présence ici. Chacun de nous doit trouver sa question. Pourquoi ? Obtenir une réponse qui lui dévoilerait le sens de sa vie ? Non : le sens de la vie ne se dévoile qu’à la fin. On ne cherche pas sa question pour trouver le sens de sa vie. On la cherche pour faire face au silence d’une pure et intraitable question. Une question qui ne posséderait aucune réponse. Une question dont le seul but serait de rappeler à celui qui la pose la part d’énigme que sa vie porte. Chaque être doit chercher sa question pour toucher du doigt l’épais mystère au cœur de son destin : ce qui ne lui sera jamais expliqué, mais qui occupera pourtant dans sa vie une place fondamentale. » « Il se peut qu’au fond chaque écrivain ne porte qu’un seul livre essentiel, une œuvre fondamentale à écrire, entre deux vides. » « Un hasard n’est jamais qu’un destin qu’on ignore. » « Je vais te donner un conseil : n’essaie jamais de dire de quoi parle un grand livre. Ou, si tu le fais, voici la seule réponse possible : rien. Un grand livre ne parle jamais que de rien, et pourtant, tout y est. » « A travers les médias, les honnêtes citoyens hésitaient. Ils voulaient la paix, mais la paix nourrissait-elle ? Ne valait-il pas mieux une crise d’où pouvait jaillir plus de dignité et de justice sociale, qu’une paix factice, qui maintenait les plus démunis dans leur condition ? Pris dans ce dilemme tragique, le peuple s’interrogeait. Ce qu’il fallait faire, c’était délibérer avec son oreiller. » « La vengeance est un plat qui ne se mange pas. Ou s’il se mange, on ne le digère pas. C’est un plat qu’on vomit. » « Tout le reste, moi compris(e), n’était qu’un décor inconsistant et factice, qu’il pouvait moduler, déplacer, enlever à sa guise comme sur une scène de théâtre. »
« Ce n’est que ça, l’homme : une créature qu’on peut prendre en pitié. »
M. Mbougar Sarr