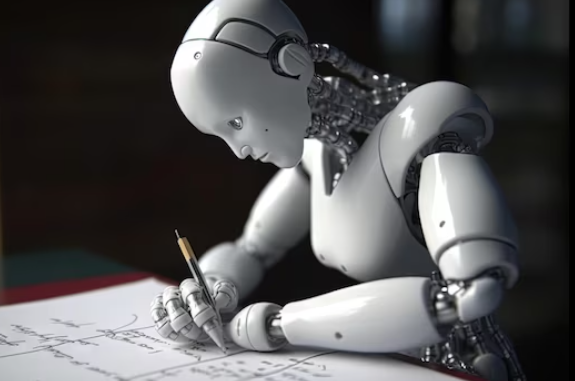Œuvre d'art abstraite.

Duras réplique, à moins qu’elle aurait changé d’avis dans cet « Ailleurs » : « C’est complètement écrit. Peut-être que vous n’avez pas lu vraiment les textes. » Réponse donnée à une participante ayant l’impression d’être devant une peinture lors de sa lecture dans le cadre d’une conférence. (Cf. Isabelle Reynauld, dans « Lire le film/voir le texte, Marguerite Duras »).
Détruire dit-elle (sans virgule selon sa typologie originelle) est l’un des romans les moins accessibles de Duras.
Je pourrais citer Isabelle Thisdale (Université du Québec) qui nous explique que toute l’œuvre de Duras est « Ruine & échec » mais à la manière du phénix. « Chaque œuvre est bâtie sur les ruines de la précédente ad vitam aeternam. L’œuvre de Duras ne s’est pas d’abord construite pour ensuite se détruire, au contraire : c’est en tirant son origine de la ruine qu’elle permet la génération. »
C’est ce qu’affirme Derrida alors qu’il écrit : « Au commencement était la ruine. En fait, c’est en considérant l’œuvre dans son ensemble qu’il est possible de constater qu’elle s’est construite et reconstruite sur ses propres ruines. Ce que Duras installe, c’est une mise en ruines de l’œuvre, une dévastation provoquée qui permet au texte de se regénérer. Il devient alors la ruine sur laquelle le texte ultérieur se posera. »
Je peux aussi citer Lucien Israël et son texte Détruire dit-elle – II, dans Marguerite D. au risque de la psychanalyse (2004) qui ne voit qu’un vivier (un aquarium) dans lequel quatre personnes s’entretiennent de mort lente avec en fond de décor la forêt : l’inconscient. (voir extrait infra).
Détruire, dit-elle est cependant une œuvre d’art textuelle dont le genre a fait se creuser les méninges. Œuvre d’art abstraite, quasiment inintelligible dans sa totalité sans connaître la biographie de l’auteure (le sens politique qui sous-tend le livre roman-scenario-pièce de théâtre) et lu les explications de texte de ses décodeurs qui éclairent les impressions/émotions ressenties.
Pour les fans de Duras, je conseille de lire le mémoire de maîtrise en études littéraires de Julie Gagnon (Université du Québec), DURAS ET DÉTRUIRE DIT-ELLE : LE LANGAGE DE LA RÉVOLUTION.
Extrait de Lucien Israël :
« J’ai fait tout mon possible pour repousser jusqu’à maintenant l’entrée dans le vif du sujet parce que, quand vous le verrez, il n’est pas tellement vif que ça. Le scénario, ce n’est pas Hitchcock. Ça se situe, pas par hasard, dans un hôtel feutré où l’on met des gens qui ne sont peut-être pas tout à fait des malades mais sûrement pas des gens très bien portants. Ils sont là en train de cultiver, pourrait-on croire, ce que j’essaierai de développer lors d’un autre entretien sous le nom de la mort lente. Mais la mort lente, ça fait encore très vivant par rapport à cette espèce d’aquarium où évolue quoi ? En fait quatre personnages et des comparses. Quatre personnages : deux hommes, deux femmes. Mais la partition, la répartition de ces personnages ne se fait pas du tout selon le plan de la partie carrée qui elle serait parfaitement conforme aux garanties contemporaines : je te le prête, tu me le prêtes. Il suffit d’augmenter d’un nombre pair de partenaires pour arriver par la voie des permutations, circulaires et autres, à un nombre impressionnant d’accouplements qui sont la garantie recherchée. La partition donc ne se fait pas comme ça. Elle peut se faire selon les modes sociologiques, modes sociologiques qui mettraient d’un côté les intellectuels, un nommé Stein, un nommé Max Thor et une nommée Alissa et de l’autre côté le groupe bourgeois représenté par une nommée Élisabeth et ses appendices qui n’ont aucune espèce d’importance. On serait bien en peine s’il fallait classer ces gens en hommes et femmes parce qu’on ne sait jamais, dans tout ce lot, qui est l’homme ou la femme de qui. On pourrait aussi tenter un classement selon les comportements et les conduites conscientes et le fond inconscient. C’est la répartition qui nous tente le plus parce qu’elle est indiquée, imposée par le décor – j’ai parlé d’aquarium. Ce n’est pas un camp romain, c’est un hôtel avec des baies qui donnent sur des pelouses, qui donnent peut-être sur un tennis. Il n’est pas indiqué si on le voit ou pas. On entend peut-être simplement les balles comme dans le premier film venu. Et l’arrière-fond, l’inconscient, c’est une forêt mystérieuse et effrayante. Imaginez là-dedans des gens assis –, je les imagine volontiers sur des chaises à roulettes dont on aurait supprimé les roulettes pour qu’ils n’aillent pas trop vite – des gens qui passent des journées entières à se contempler. Max Thor, par exemple, semble être enseignant quelque part. On le sait parce qu’il endort ses étudiants ce qui lui permet d’en réveiller une de temps en temps, Alissa par exemple. »
Lucien Israël