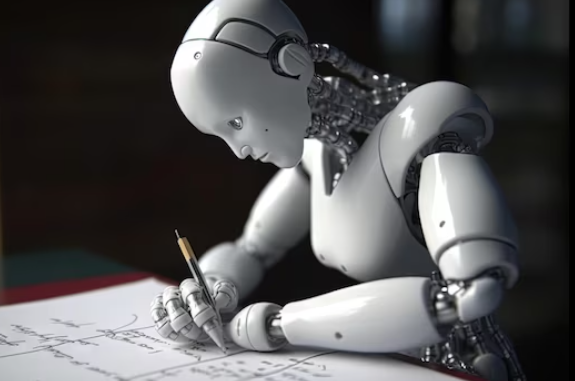L'humanité, une cruauté des dieux ?
"L'écume de mer est un chien qui aboie aux étoiles."
Âmes sensibles, s'abstenir.

Si vivre paisiblement aujourd’hui en temps de « paix » est quasiment une utopie que dire de ceux qui ont réchappé des guerres et de l’exil ?
Un livre poignant à lire où les prairies verdoyantes et les ciels lumineux côtoient posément, poétiquement, la boue des tranchées « de la terre jaune, collante. Dans un monde glissant et savonneux. » qui jaillit de la fumée d’un noir multicolore des souvenirs de l’auteur, en désordre malgré un ordre apparent 1. la maladie, qui « ressort » la guerre trente ans plus tard. 2. Le soldat. 3. Le déserteur. « Car la mémoire parle une langue étrangère. »
« Je commence à comprendre que l'écriture est une représentation graphique de ma mémoire. Ce qui m'est arrivé peut-être important pour les autres. On peut guérir l'oubli par l'écriture. Cette merveilleuse architecture qui relie le présent et le passé dans une relation stable. La mémoire se perd, mais l'écriture demeure. L'imbécile se souvient et l'homme sage note. C'est le rôle de la littérature. Pas de réponses, mais de vraies questions. Pour que tout ait l'air aussi "sérieux" que possible, j'écris mes questions au stylo noir et en majuscules. Comme si je voulais crier plus fort que ma solitude. Et que la peur. »
« La littérature est la dernière alliée de la mémoire. La dernière ligne de l’humanité. Le papier de tournesol avec lequel nous testons l’acidité du monde. »
« À mesure que la guerre progresse, j'ai le sentiment de devenir un chien. Je commence à sentir de vrais bouquets de nouvelles odeurs. Les fruits avariés et la chair pourrie. L'odeur d'une maison cramée. La puanteur sucrée de la viande trouvée dans le réfrigérateur d'une maison abandonnée. La putréfaction douce d'une vache morte, la puanteur légèrement plus vive d'un cadavre humain. L'odeur savoureuse de l'herbe fraîche alors que je m'allonge face contre terre. Les effluves des feuilles mouillées scintillant sous la pluie du printemps. Le parfum sucré des cerisiers en fleur. Un tout nouveau monde s'offre à moi. La puanteur. »
Lire Sunset Park de Paul Auster me sera sans doute plus difficile.
Je l’entrevois ainsi. Entre Velibor Čolić et moi, il y a l’écran du non-vécu qui protège les générations ayant pu vivre jusqu’à présent quasi « paisiblement ». L’empathie est présente à la manière dont on peut lire encore les ouvrages contant la misère et la dureté du 19e siècle, Hugo, Dickens, Balzac, Dostoïevski, etc., puis Faulkner pour le 20e… Avec Auster, c’est une tout autre guerre. D’une ampleur inconnue, globalisée contre l’humanité toute entière. Qui se déroule au temps présent et dont nous sommes perfidement, directement et indifféremment, la cible. Peur et puanteur suintent au quotidien.
Je reviens sur mon article avec ce complément :
Ce livre doit tellement être lu que pour une fois j’avais dérogé à mon habitude de n’écrire qu’après lecture intégrale, le terminant avec ces mots : « lire Sunset Park de Paul Auster me sera sans doute plus difficile… »
Cette nuit j’ai cauchemardé.
Comme pour exhorter le mal, j’ajoute avec la notice « Attention, ce programme comporte des scènes de violence qui peuvent affecter les âmes sensibles », un passage du livre qui me semble la plus « fine » démonstration – on peut même dire la plus « élégante » – de la folle violence dans laquelle on baigne…
Lorsqu’on me parle aujourd’hui d’espoir, celui-ci coule comme de la morve au nez d’un chérubin abandonné !
Bonne journée quand même aux lecteurs dans la clarté du bleu du ciel…
« Il a toujours sur lui [un des soldats croates dans la guerre contre la Serbie] un sac en plastique rempli de diverses pilules. Un vrai commerce de proximité. Des bonbons (en italiques) inconnus rose tendre, bleu clair ou orange sur sa paume puante. J’achète et j’avale ces arcs-en-ciel chimiques sans réfléchir. Ensuite j’attends les résultats. C’est souvent de la diarrhée, ou un mal de tête. Mais parfois, le monde devant moi se transforme en dessin animé. Une sorte d’euphorie accélérée à la Tex Avery. Quelques-uns de mes camarades prennent également ces pilules. Ce sont probablement des scènes effrayantes à voir. Des soldats nerveux et drogués bourdonnant comme un essaim de guêpes folles. Un regard, un geste ou un mot et tout peut basculer dans le chaos.
Cet état de folie peut durer des heures.
Un jour, bien défoncés, nous tombons sur une femme sans seins derrière une maison. Elle est allongée sur le dos dans une chemise de nuit blanche. Une main inconnue l’a placée dans la position d’une étoile, les jambes et les bras écartés comme l’Homme de Vitruve de Léonard de Vinci. Nous sommes chauds, bruyants, fous de toute cette chimie qui frappe nos cerveaux. Pendant que d’autres plaisantent, je m’approche du cadavre. Son visage est aussi pâle que la craie. Les yeux calmement fermés. Les prunes bleues de ses ecchymoses se distinguent sur son cou étonnamment fin. Il y a encore quelques heures, cette femme était jeune. Maintenant, elle est morte.
Une force laide et invisible est passée sur son corps. Elle a déchiré sa chemise et coupé chirurgicalement ses seins. Il y a maintenant deux trous rouges sur sa poitrine. J’imagine la scène. Des soldats et leurs bras, leurs jambes, leurs uniformes et leur haleine ivre. Et cette fille qui se bat, mord, hurle. Puis elle abandonne. Les soldats passent sur son corps. Elle est calme, seuls quelques grognements et sanglots font bouger son corps. Le dernier soldat sort un couteau. Ils respirent tous les deux difficilement. Puis l’homme, poussé par des impulsions folles, coupe ses seins. Du sang, je vois du sang. Alors le Prince Noir descend du ciel clair et bleu et embrasse la fille sur le front avec des lèvres froides. Et il donne à son corps la forme d’une étoile.
Nous nous tenons en demi-cercle autour d’elle. La chimie travaille dans mon cerveau. Je me demande bêtement si elle est toujours une femme après sa mort ? Ou la mort efface-t-elle le genre ? Beaucoup de sang. Non loin de là se trouve un seau plein d’eau. Dalibor, le plus fou d’entre nous, prend ce seau et le renverse sur le macchabée. En un bref instant je vois : la femme bouge. Paresseuse, comme si elle se réveillait après un long sommeil. Un gros soupir et l’instant d’après elle est assise. Elle regarde avec étonnement le sang sur ses mains et sur sa robe. Puis elle lève la tête et nous regarde. Son visage est bleu foncé, comme une prune.
Un des soldats crie : foutons le camp d’ici, c’est un putain de vampire !
La femme bouge encore. Un cri terrible et inhumain s’échappe de sa bouche blessée.
Nous faisons demi-tour et courons dans la forêt en désarroi. Nous courons une dizaine de minutes, puis nous nous arrêtons. Nous buvons dans nos gourdes militaires, nous fumons.
–– Elle est comme moi, rigole Dalibor, elle est allergique à l’eau.
Le soldat Dalibor est un jeune loup. Un beau gosse, un briseur qui fracasse tout autour de lui avec la puissance d’un bulldozer. Un ivrogne et un bagarreur. Un tireur d’élite cynique et particulièrement doué. Il tire sur tout ce qui bouge, sur les animaux, les soldats serbes, les nuages, les oiseaux. Et il ne loupe jamais sa cible. Dalibor tire sans réfléchir, sans remords, sans aucune trace de haine. Mécaniquement il porte son fusil à sa joue et tire un instant plus tard. (…). »