Ce qui est sans être tout à fait.
« Le vide quantique est tout sauf vide. »
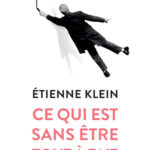
Résumé : « Le vide, dit-on ordinairement, est ce qui reste après qu’on a tout enlevé. Mais si l’on retirait absolument tout, il ne resterait plus rien… du tout. Pas même le vide. Alors peut-on réellement faire le vide ? Au demeurant, le vide existe-t-il vraiment ? A-t-il même jamais existé ? »
Petit aperçu des questions auxquelles Etienne Klein répond, du moins tente… Ce qui est certain est qu’avec ce petit livre « léger » (façon de parler) disons que le ciel redevient bleu dans l’imaginaire…
Le vide est un "cabinet de curiosités". « Dans notre langage est déposée toute une mythologie. » (Ludwig Wittgenstein).
« Vaste désert géométrique, arrière-monde empli d’entités nomades et léthargiques qui serait la matrice de la matière, sorte d’éther dépourvu de toute matérialité mais pleinement existant, quintessence cosmique dynamisant en sourdine l’expansion de l’Univers… (...) avec ses multiples concepts appelés « temps », « espace », « vide », « matière », « énergie », sans que les mêmes mots recouvrent les mêmes réalités... »
« Les avatars du vide contemporain, au double sens du terme – aventures ou mésaventures, et pluralité d’incarnations – , sont les marqueurs d’un inaboutissement conceptuel : à l’évidence, le « fond du fond des choses » n’a pas été dévoilé, identifié, compris, tant s’en faut. »
Disséquant nos connaissances (les idées qui ont traversé et imbibé nos cerveaux depuis des temps fossilisés à nos jours) sous nombre de leurs impacts sociologiques pour les reformuler brièvement avec brio, Etienne Klein nous embarque dans un fabuleux voyage scientifique, philosophique et poétique… D’Aristote à Wittgenstein – ou de A à W pour me limiter à ces deux premières lettres des noms des philosophes, poètes et scientifiques conviés à la « grande messe » (Artaud, Bachelard, Bergson, Démocrite, Diderot, Levinas, Miró, Parménide, Platon, Clément Rosset, etc., la liste est bien trop longue pour tous les citer !), il est évidemment riche et savoureux.
Ainsi, si vous voulez tout savoir sur le vide, il est conseillé de le faire déjà dans la tête pour l’emplir, ensuite, de ce qu’Étienne Klein excellant dans l’art d’expliquer simplement raconte à son propos en faisant le tour de ce « néant » ce « chaos » ce « vide » ce « non-être qui est » décliné en philosophie « en une palette baroque » et persiste en physique.
« Le vide quantique est, nous l’avons dit, un espace empli de paires de particules et d’antiparticules virtuelles qui sans cesse se matérialisent et s’annihilent aussitôt. Mais au bord de la surface d’un trou noir, l’énergie du champ gravitationnel est si intense que les particules et les antiparticules virtuelles qui forment ces couples furtifs (électron/positron) peuvent emprunter une part de cette énergie et se matérialiser pour de bon. »
Cette longue histoire du vide nous transporte d’évidence vers les trous noirs dont les bords sont gris et d’où s’échappent parfois « des ombres fantomatiques surgissant dans le monde réel. »
Pour ma part j’ai jubilé (je crois que le mot n’est pas trop fort) à la découverte du modèle du vide quantique proposé par Paul Dirac (modèle « poétique » aujourd’hui délaissé) :
« Une mer inobservable gorgée d’électrons d’énergie négative. »
Mais son remplaçant actuel (que je vous laisse découvrir) n’en est pas moins tout aussi jubilatoire, me faisant imaginer dans celui-ci les traces de cet inconscient collectif qui nous tiraille…
Autre point vivement appréciable dans ce tout petit livre (167 pages parfaitement condensées) : Etienne Klein pointe l’énorme problématique de la sémantique :
Ces avatars du vide indiquent également la nécessité de revoir certains modes de désignation : trop de significations dispersées sont données à un seul et même mot… Or, comme l’avait déjà noté Antoine Laurent de Lavoisier, l’inventeur de la chimie moderne, la science réclame, lorsqu’elle progresse, que le langage lui-même soit perfectionné : "On ne peut perfectionner le langage sans perfectionner la science, ni la science sans le langage, et quelque certains que fussent les faits, quelque justes que fussent les idées qu’ils auraient fait naître, ils ne transmettraient encore que des impressions fausses, si nous n’avions pas des expressions exactes pour les rendre." De tels propos, tenus au moment de la Révolution française, demeurent d’une grande justesse, alors même que la production des connaissances s’accélère. Irréductiblement, un déphasage s’accroît entre ce qui est communément dit et ce qui est nouvellement su. […] (p. 164).
Une telle continuité sémantique en dépit des métamorphoses du signifié interroge : provient-elle de ce que les concepts physiques fondamentaux sont toujours solidaires de catégories plus générales de la pensée qui, elles, ne varieraient quasiment pas ? Ou bien de jeux de langage peu évolutifs qui orienteraient systématiquement nos façons de dire, par conséquent de réfléchir ?
L’ouvrage conclut rappelant la Loi dans Le Procès de Kafka quand l’homme bloqué par une sentinelle stupide « a attendu en vain, et finit par mourir, sans rien savoir de plus. »
Un ouvrage dévoré…